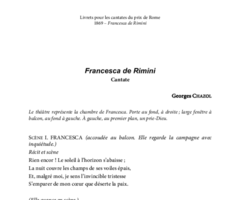Le prix de Rome
LE PRIX DE ROME.
Les concours scolaires du Conservatoire sont précédés depuis quelques années, dans la petite salle même des exercices du Conservatoire, du concours annuel pour le grand-prix de composition musicale, dit autrefois de Rome ou plutôt de l’Institut. Là, les jeunes musiciens, qu’ils soient ou non élèves du Conservatoire, ont le droit de briguer le prix de Rome, et ce ne sont plus les membres de l’Institut qui sont appelés à les juger, les membres du jury sont aujourd’hui tirés au sort et, le plus souvent, les concurrents ne s’en trouvent pas mieux, au contraire. Ainsi, l’an dernier, ce ne sont pas les meilleurs disciples de M. Ambroise Thomas qui ont remporté le grand-prix, partagé avec peu de raison, tandis que cette année M. Salvayre, élève dont toute la presse annonçait le succès à l’avance, n’est même pas admis au partage. Ce sont là des hasards du concours, sorte de loterie impossible à diriger quand on ne tient pas compte des études plus ou moins fortes réalisées par les concurrents. Ce n’est pas que cette observation doive personnellement profiter à M. Salvayre contre M. Taudou, qui a fait d’excellentes études d’harmonie et de composition, avec MM. Savard et Reber, seulement on reconnaîtra qu’elle est d’application générale. Tout ce qui précède ne veut donc point insinuer que le prix ait été mal donné, mais seulement qu’il aurait pu être partagé cette année avec infiniment plus de raison que l’an dernier. Du reste, la défaite de M. Salvayre est presque glorieuse. On écrit déjà son histoire dans les journaux, et il n’a que vingt-deux ans ! « Tout n’est pas rose dans la carrière des artistes, dit le journal Paris : Un des concurrents, M. Salvayre, que l’opinion des connaisseurs désignait pour le prix, a eu de rudes commencements. Il a vingt-deux ans. Arrivant de Toulouse ou de Montauban à Paris, il y a quatre ans, il fut obligé pour vivre de racler du violoncelle à l’Eldorado, à raison de 90 fr. par mois. Il accompagnait dans l’orchestre les chansons du crû. Élève de prédilection de M. Ambroise Thomas, cette amitié de son savant professeur ne lui a guère servi. Thomas est un Spartiate, et il a dit à M. Salvayre, son disciple : Ne comptez pas sur moi, je ne m’abaisserai pas à vous recommander ; vous avez trop de talent pour cela ? ». La vérité est que M. Ambroise Thomas ne recommande jamais ses élèves ; c’est un grand principe chez lui, mais qui parfois lui vaut de cruelles déceptions. L’an dernier, nous le répétons, ce n’est pas son meilleur élève qui arrive, et, cette année, au retour de son inspection des succursales de notre Conservatoire, il trouvera distancé son disciple de prédilection, – un vrai musicien, déjà compositeur remarquable, – mais il jouira aussi des justes consolations apportées par la presse à M. Salvayre. A propos de ce concours du grand-prix, entrons avec le Figaro dans la petite salle des exercices du Conservatoire, et laissons courir la plume spirituelle de M. Emile Blavet, en l’arrêtant toutefois à l’endroit de l’honorable M. Emile Réty, au sujet duquel ses informations demeurent injustes autant qu’inexactes : aussi nous en permettons-nous la suppression. « J’ai partagé hier, avec une vingtaine d’élus, l’ineffable privilège d’essuyer, quatre heures durant, au Conservatoire, le feu de six cantates-chassepot, armées en guerre à la conquête du prix de Rome. Six cantates, entendez-vous bien !... Si ce n’était du dévouement, ce serait de la folie. Thème à développer : les Amours de Francesca di Rimini, cette sinistre légende écrite en lettres de feu par Dante, et si dramatiquement mise à la scène par Silvio Pellico. Hâtons-nous de dire que le livret, soumis aux concurrents, n’a que de vagues affinités avec ces deux chefs-d’œuvre. De midi à quatre heures, les pauvres victimes d’une liaison incestueuse ont été poignardées six fois, – j’allais dire exécutées. Alighieri n’avait pas prévu ce surcroît de châtiment. Ah ! la justice du ciel est implacable. On m’affirme que la censure a fait des façons pour autoriser le mot adultère. Bien gros mot pour de tout jeunes gens ! prétendait-elle. Passe pour la chose, mais le mot ! Excellente mère, va ! Mais procédons par ordre. L’entrée du paradis est assurément plus facile que celle du Conservatoire. Un instant j’ai ru qu’on allait exiger mon certificat de vaccine. Enfin, je pénètre et je me trouve nez à nez avec M. Auber, à qui je serre la main. Vous comptez, n’est-ce pas, sur une de ces saillies si familières au maître ? Détrompez-vous… le maître n’en a pas fait. Il avait bien autre chose à faire. Tous les membres du jury sont à leur poste. Seul, M. Semet manque à l’appel. Où peut-il être ? Sans doute à diriger la répétition de Fadette. Il arrive et s’excuse. On nous invite à passer dans la salle des examens. L’aspect de cette salle est glacial. Tout y sent le vieux et comme le moisi. Vieille l’estrade, où tout à l’heure Francesca va dire des fadeurs à Paolo ; vieux le piano, leur futur complice ; vieux le tapis vert sur lequel se débattront leurs destinées. La décoration de ce théâtricule est dans le goût égyptien ; le vert d’eau s’y marie désagréablement avec un indigo criard. On nous aligne, comme des momies, sur des banquettes poudreuses. Je m’attends à voir paraître l’embaumeur. C’est le jury qui fait son entrée. Ces messieurs prennent place comme il suit : au centre, M. Auber, enveloppé dans un double paletot, et les pieds sur une chaufferette ; à sa droite, MM. Saint-Saëns, Semet, Boulanger et Labarre ; à sa gauche, MM. Reyer, Ermel et Limnander. M. Bizet joue le rôle de juré volant ; il va de collègue en collègue, comme l’abeille va de fleur en fleur. C’est un miel ! dirait mademoiselle Cascadette. En entrant, ces messieurs échangent de cordiales poignées de main avec un personnage qui m’intrigue au dernier point. C’est un vieillard à barbe blanche, à l’air important, protecteur et affairé, jurant avec la livrée dont il est revêtu. Bonjour, papa Leborne ! Papa Leborne, ça va bien ? Et papa Leborne par-ci, papa Leborne par-là ! Lui s’en va, trottinant de droite et de gauche, distribuant des sourires, des saluts, des tapes sur la joue, débitant des aménités ou des gaillardises, offrant ou acceptant des prises de tabac. Papa Leborne compte trente-trois ans de services au Conservatoire. Pas plus que M. Auber, il ne réussit à vieillir.
On appelle les cantates, qui sont exécutées dans l’ordre suivant : 1° M. Taudou (élève de M. Reber). – Exécutants : Mademoiselle Priola, Francesca ; M. Bosquin, Paolo ; M. Bouihy, Malatesta. 2° M. Salvayre (Ambroise-Thomas). – Exécutants : Madame Brunet-Lafleur et MM. Nicot et Gailhard. 3° M. Flégier (Ambroise-Thomas). – Exécutants : Madame Sass et MM. Maurel et Grisy. 4° M. Fouque (Ambroise Thomas). – Exécutants : Madame Meillet et MM. Bonnehée et Valdéjo. 5° M. Serpette (Ambroise Thomas). – Exécutants : Mademoiselle Van-Ghell et MM. Achard et Gailhard. 6° M. Pilot (Ambroise Thomas). – Exécutants : Mademoiselle Baretti et MM. Bataille et Miquel.
Dieu me garde de marcher dans les plates-bandes de mon confrère Bénédict, et de faire ici de la critique transcendantale. Mais l’obligeance des artistes nous fait un devoir de rendre à chacun d’eux ce qui lui revient. Parmi les dames Mmes Priola, Meillet, Van-Ghell et Brunet-Lafleur ont droit à des éloges tout particuliers, cette dernière surtout, que nous regretterons vivement de ne plus entendre à l’Opéra-Comique. Quant à Mme Sass, son rhume ne justifiait ni ses mines ni ses allures à l’enfant. Parmi les hommes, nos félicitations à MM. Achard, Bosquin, Nicot, Bonnehée et Gailhard, à qui son organe exceptionnel promet, un jour ou l’autre, la place d’honneur à l’Opéra. Voulez-vous connaître la physionomie des jurés pendant cette longue séance ? M. Auber n’a pas quitté des yeux les partitions, les suivant note par note, avec la même conscience que ses deux assesseurs, MM. Reyer et Saint-Saëns. M. Semet regardait par-dessus l’épaule de celui-ci, et M. Boulanger par-dessus l’épaule de M. Semet. M. Labarre se caressait la barbe avec des sourires de Jupiter olympien. M. Ermel marquait la mesure, et M. Limnander crayonnait des bonshommes. Quant à M. Bizet… prière de voir ci-dessus. Aussitôt la dernière mesure envolée, on fait évacuer la salle, et les jurés restent seuls en face de leur conscience et de plusieurs mains de papier blanc. Mon rôle est fini, et je regarde d’un œil ému les jeunes aspirants à la Villa Médicis, qui forment de-ci de-là, avec leurs interprètes, des groupes où l’anxiété met son ombre et l’espoir son rayon. Tout à coup, la porte s’ouvre et l’huissier appelle : – M. Taudou ! Et tandis que ce jeune homme à l’œil noir – la fleur de Perpignan – entre radieux chez ses juges, ses rivaux infortunés s’éloignent avec un soupir. « Au nom du jury dit M. Auber au lauréat, je vous décerne le grand prix de Rome » ! M. Taudou remercie et rentre dans la salle des Pas-Perdus, où il embrasse tout le monde, comme dans le Petit Faust, et jusqu’à Mlle Priola qui se laisse faire sans trop de façon. C’est jugé ne discutons pas. Je dirai donc volontiers à M. Taudou : « Que la Ville-Sainte vous soit propice ! » Mais je dirai aussi à M. Salvayre : « Courage ! vous avez fait œuvre d’artiste ; votre sérénade est une perle, et il y a quelque chose du souffle dantesque dans votre trio. Il n’est pas nécessaire d’aller à Rome pour être un compositeur de talent. Faites comme si vous en étiez revenu.
ÉMILE BLAVET.
Personnes en lien
Documents et archives
Permalien
date de publication : 15/10/23